L’art contemporain tout au long du 21e siècle raconté par un chef d’œuvre.
Une année passa dans ce qui était devenu un espace sans vie. Personne pour entretenir les lieux. Les rideaux des fenêtres restaient tirés. Les plantes que Marthe n’avait pas emportées avec elle séchaient sur pied. Une année de silence total. Cruellement amplifiés par l’absence absolue, écrasante, étouffante, du moindre bruit, on entendait parfois les pas des voisins du dessus ou les sons ouatés d’un programme audiovisuel dans les appartements contigus.
Le ciel, mon compagnon fantasque, était masqué d’un voile opaque qui, de jour, ne laissait passer dans la pièce qu’une faible lumière. La cheminée éteinte ne réchauffait plus l’air qui devenait glacé et humide. La petite terrasse, dépouillée de son opulent jardin, faisait grise mine: la chaise longue de Marthe, pliée contre un mur, moisissait lentement et les quelques pots de terre abandonnés là n’abritaient plus que des branches nues ou des herbes folles, maigrichonnes et vite dépérissantes. Les livres de la bibliothèque se couvraient doucement d’une couche de poussière. Le fauteuil vert gardait en creux la marque du corps de Riri.
Finalement Marthe, accompagnée d’hommes aux bras puissants et tatoués, débarqua un jour. Ils firent un grand travail de tri dans la pièce. C’était le déménagement. Tout allait être dispersé. Je compris que, contrairement à d’autres objets qui repartaient à Pékin, j’avais été acquis par l’État français, comme une sorte de taxe sur le patrimoine du mort. J’allais intégrer définitivement ce qu’ils appelaient les «Collections nationales».
En fait de nouveauté, cela se traduisit par un retour dans les sous-sols de Montreuil.
Je suis resté environ vingt cinq ans dans ce sous-sol. C’est long. Section nord, allée R, rangée 28, posé sur un casier métallique au fond molletonné d’une feutrine confortable, et recouvert d’un tissu transparent. Étiqueté et abandonné là, comme tous les autres. C’est très très long, vingt cinq ans! Très peu d’activités. De rares visites. Des occasions de divertissements trop occasionnelles. Imaginez-vous une vie d’attente, rangé dans un placard, presqu’une tombe. On a le temps de ressasser. Le temps de se remémorer le passé. D’espérer le retour d’une vie plus active. On n’a que ça à faire: patienter. Une vie à demeurer.
Il y avait la section des petits objets, mon territoire. Au fond à gauche, celle des peintures et des grands formats, dans de grandes pièces aux plafonds élevés. Et puis celle des dessins et de la photographie, dans les salles à ma droite. À l’autre bout des réserves se trouvaient les objets volumineux, une zone invisible depuis mon emplacement. Je pouvais seulement assister aux déménagements: de la grande porte métallique vers ce secteur, ou inversement, les œuvres se déplaçaient grâce à de petits véhicules électriques très puissants, qui traversaient bravement le sous-sol, vigoureux et réguliers. Ils suivaient sagement des réseaux de circulations peints au sol, bandes inclinées noires et orange. Ils étaient auréolés d’une petite lampe jaune qui clignotait joyeusement, tandis qu’un sifflet guilleret accompagnait systématiquement leur manège.
Au début, pour passer le temps, je comptais les étages des meubles qui m’entouraient: sept niveaux de rangement pour les grandes armoires à droite, onze pour les rayonnages métalliques perpendiculaires. Les petits placards disposés en bout de rangée comportaient seize rayons. Les armoires avaient un premier palier de casiers verticaux, je comptais six compartiments dans les quatre divisions de chaque meuble. Les étagères centrales, qui se déplaçaient sur des rails pour ouvrir ou réduire les allées, étaient équipées à leur sommet d’une tringle supportant de petites échelles verticales qui coulissaient sur toute leur longueur en grinçant un peu. Mais mon territoire fut vite épuisé, et je faisais le compte des meubles que je pouvais voir dans les espaces voisins. Dans la section des dessins, les gros bahuts en bois comptaient vingt deux tiroirs fins contenant des planches de papier ou des photographies, délicatement posées à plat et séparés de feuilles blanches. Du côté des grands formats, je dénombrais exactement quatorze poignées électroniques qui permettaient, quand on les actionnait, d’ouvrir des parois verticales, repérées par un code, ceux que j’apercevais allant de D6 à D20. Disposés sur ces tiroirs verticaux, les tableaux ou les photos dans de grands cadres étaient étiquetés individuellement à l’aide de puces.
Dans cette organisation qui se voulait parfaite, il y avait aussi les inévitables trublions, les empêcheurs de tourner en rond, les inclassables. Par exemple, cette chaise en bois et métal qui resta des années dans une allée avec simplement une feuille scotchée sur son dossier portant cette inscription: «Ceci est une œuvre d’art: ne pas toucher». Et on ne la toucha pas, pendant longtemps. Ou bien cette machine mécanique, qu’on avait dû classer comme moi dans les petits objets, mais que son poids empêchait de ranger sur une étagère. On la posa au sol dans la rangée du fond, non loin de moi, avec son manteau transparent et son étiquette. Régulièrement, les magasiniers se prenaient les pieds dedans. On décida donc un jour de lui trouver une place, chez les encombrants je crois. Je me souviens aussi de ce ballon rouge, qui traîna longtemps dans la réserve, servant parfois de distraction espiègle à un magasinier qui jonglait avec ou shootait dedans. Les conservateurs le déplaçaient distraitement d’un petit coup du pied quand il se trouvait sur leur passage. L’un d’eux s’aperçut un jour qu’il était un élément d’une œuvre volumineuse, ce qui provoqua une scène hautement comique. Il y eu des éclats de voix, des remontrances. On le prit délicatement, avec des gants blancs, on l’envoya à la restauration pour évaluer les dégâts, puis il disparut définitivement dans la caisse qu’il n’aurait jamais dû quitter.
Parfois je cherchais à deviner sous leur voile l’apparence de mes colocataires, mais la lumière médiocre et les positions variées dans lesquelles on nous installait (debout, couché, tête bêche : seuls comptaient ici l’équilibre parfait et l’encombrement minimum), rendaient toute identification imprécise. Il y avait des formes qui évoquaient des éléments naturels, des boules, des cônes, des fleurs et des étoiles, des osselets, des nervures végétales. D’autres faisaient plutôt songer à des éléments mécaniques ou architectoniques, des écrous, des roues dentées, des contreforts et des treillis. Je reconnus quelques objets à silhouette humaine, des têtes, des crânes, des sortes de poupées, réduites ou à échelle réelle; des objets utilitaires avaient, pour une raison ou pour une autre, changé de statut pour devenir des œuvres du musée de Montreuil: une horloge ronde à mes côtés, des ustensiles de cuisine en face, une vieille machine à écrire dans la rangée 27, une lampe de bureau à l’étage inférieur, un fer à repasser; certains étaient des miniatures de constructions humaines, des maquettes d’architecture, des réductions de véhicules en matière plastique. Mais, sous leur linceul, la plupart des résidents composaient une masse informe, inidentifiable. Rangés ergonomiquement, nous n’avions plus rien à voir avec ce que l’on exposait fièrement dans le musée. Ainsi disposés, nous ne ressemblions plus à grand-chose. Dans notre sous-sol, nous faisions peine à voir.
Auteur: Hubert Renard
Éditeur: art&fiction
Genre: extrait
Relecteur: Julien Gabet
Mots clé: galerie, musée, œuvres, réserves, sous-sol, Nouveau Louvre
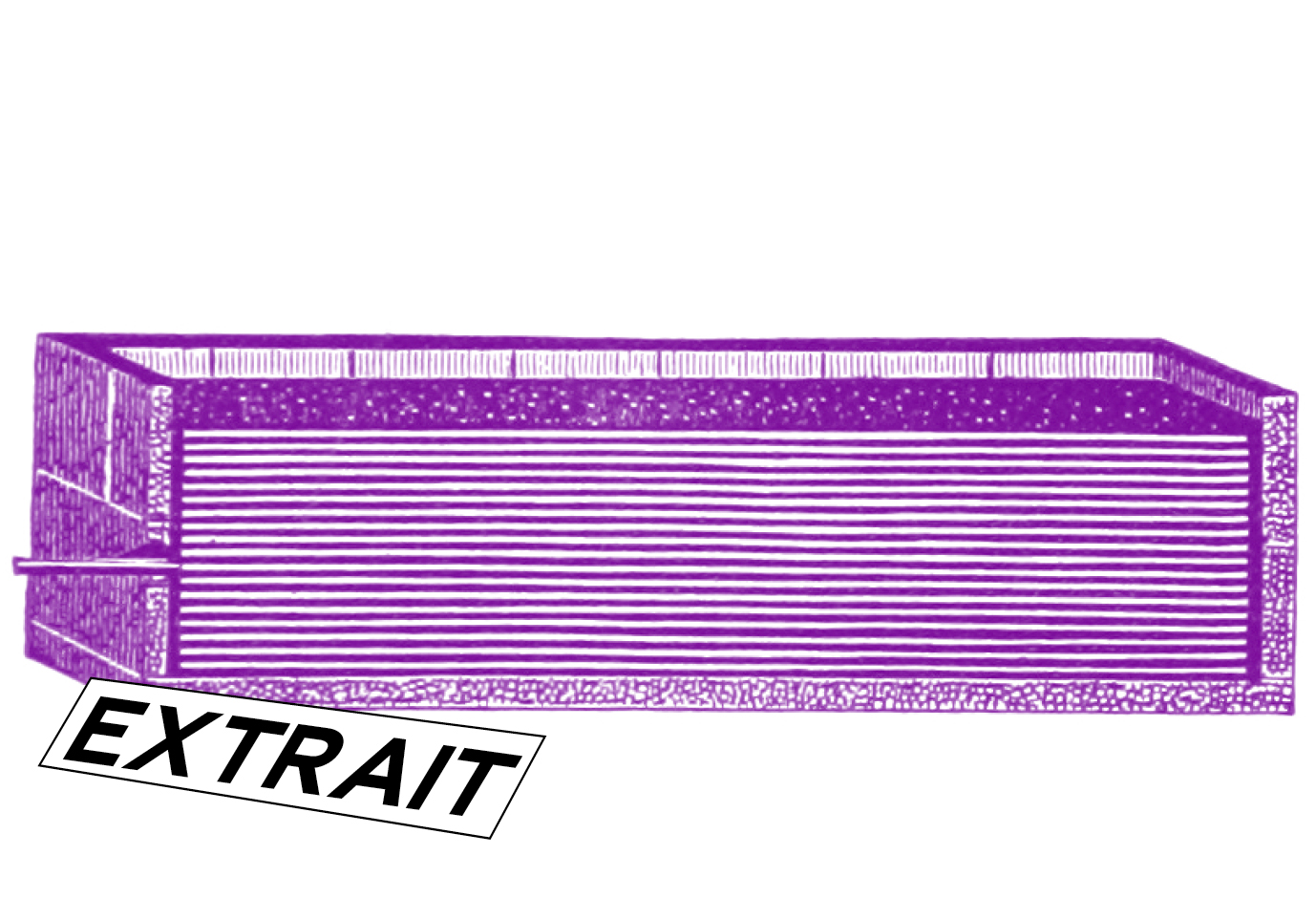
0 commentaires